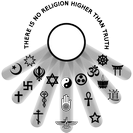91
PENSÉES SUR LE NOUVEL AN ET LES FAUX NEZ
1890, salut!
«Annum novum faustum felicemque tibi!»
Telle fut la phrase sacramentelle dans la bouche de tout gentil, grand ou petit, riche ou pauvre, pendant la journée du 1er janvier, des siècles avant l’ère chrétienne; telle nous l’entendons encore aujourd'hui, surtout à Paris. Ce souhait mutuel s'échangait au susdit jour dans toute l’étendue de l’Empire romain. Il réveillait les échos du palais des Césars, égayait le pauvre taudis de l’esclave, et montait aux nuages dans les vastes galeries ouvertes du Colisée, au Capitole et au Forum, partout sous le ciel bleu de Rome. Ce jour-là, tout le monde s’affublait, en l’honneur de Janus, à la double face, d’un faux nez plus ou moins saillant, de bonte, de franche cordialité et de sincérité.
«Que la nouvelle ANNÉE vous apporte bonheur et prospérité!» disons-nous à chacun de nos lecteurs! «Qu’elle vous soit légère», disons-nous à nos ennemis et détracteurs. Frères! —disons-nous à tous les théosophes dans toutes les parties du monde,—Frères, débarrassons-nous, pour ce jour, du moins, de nos faux nez respectifs, pour nous souhaiter réciproquement santé et succès, et, surtout, un peu plus d’entente cordiale que pendant l’année 1889, heureusement décédée.
Cependant, que nous répétions la vieille formule latine d'une manière ou d’une autre, en français ou en anglais, ce ne sera toujours qu’une variation sur l’ancienne phrase païenne. Car le nouvel an, ainsi que toute autre fête, n’est qu’un legs fait aux peuples chrétiens par les adorateurs des dieux de l’Olympe. Échangeons donc souhaits et étrennes, mais ne soyons pas ingrats, theosophes. N’oublions pas que nous tenons ces coutumes du paganisme; et que félicitations et étrennes nous viennent de la même source.
92 En effet, les étrennes ne sont que les strenae, les présents échangés par les Latins au ler janvier, le jour qui ouvrait le nouvel an.[1] Comme tout le monde sait,—ou ne sait pas, ce qui m’est bien égal,—ce jour était consacré à Janus, lequel donna son nom au mois de Januarius ou janvier, et même au saint de ce nom, patron de Naple et de ses lazzaroni. Mais cet aimable saint n’est, après tout, qu’un des faux nez du dieu Bifrons. Le vieux païen s’appelait, dans sa première jeunesse, Diaus de son nom védique, le beau dieu du jour et de la lumière. Après avoir émigré en Thessalie, et de là en Italie, où il s’établit sur le Tibre dans son petit hameau du Janiculum, il fit latiniser son nom et devint Dianus, dieu de la lumière (d’où Diane). Ses faux nez furent nombreux, et l’histoire n’en sait plus le nombre. Mais il s’est laissé convertir depuis; et voici maintenent plus de dix-huit siècles, qu’ayant remplacé son dernier et modeste faux nez par un masque plus respectable, sinon plus impénétrable—il se nomme saint Pierre.
Que le lecteur veuille bien ne pas se récrier, et qu’il s’abstienne surtout d’épithètes malsonnantes à notre addresse, lesquelles ne nous feraient aucun mal, mais pourraient lui faire du tort,—à nos yeux. Je ne suis que l’humble interprète des vérites et symboles plus ou moins voilés, mais fort connus de tous ceux qui ont étudié leur Virgile et leur Horace, ainsi que leur Ovide. Ni faux nez, ni masque, ne pourraient empêcher un vieux païen de reconnaître, dans l’apôtre qui renia son Maître, son Janus à double face. Les deux son identiques, et tout le monde a le droit dc prendre son bien où il le trouve. Saint Pierre n’est le coeli Janitor que parce que Janus le fut. Le vieux concierge du ciel, qui tirait le cordon de la porte du palais du Soleil, à chaque nouveau jour, comme à chaque nouvel an, et la refermait sur eux, en les reconduisant, n’est que trop reconnaissable dans son nouveau rôle. Il était écrit, dans les étoiles qui gouvernent la destinée des dieux comme celle des mortels, que Janus,—qui tenait la clef du ciel dans une main et une hallebarde de l’autre, tout comme saint 93Pierre le fait depuis qu’il lui a succédé,—céderait sa place de portier du Soleil à celui qui deviendrait le gardien des portes du Paradis,—la demeure du Christ-Soleil. Le nouveau coeli Janitor a succédé à toutes les fonctions et privilèges de l’ancien, et nous n’y voyons aucun mal. Salomon l’a dit; «Il n’y a rien de nouveau sous le soleil»;—et il a bien dit. On serait joliment bête d’aller inventer de nouvelles fonctions ou de nouveaux dieux,—que nous créons à notre image,—lorsque nos pères d’au delà du Déluge avaient si bien pris cette peine pour nous. C’est pour cela que tout est resté comme par le passé et que rien n’est changé dans ce monde,—sauf les noms. Dans toutes les cérémonies religieuses le nom de Janus était toujours invoqué le premier, car ce n’est que par son immédiate intercession que les prières des fidèles idolâtres pouvaient parvenir aux oreilles des dieux immortels. Maintenant, il en est de même. Celui qui croirait communiquer avec l’un des personnages de la trinité par-dessus la tête de saint Pierre serait bien attrappé. Sa prière subirait le sort d’une supplique qu’on chercherait à laisser dans la loge du concierge, après avoir eu des mots avec lui et l’avoir appelé «vieux portier»: elle n’arriverait jamais aux étages supérieurs.
Le fait est que la Grande armée des «Pipelets»[2] et des «Anastasies» devrait avoir pour patron reconnu Janus Bifrons, le dieu à l’image de qui elle se créa. Ce n’est qu’alors qu’elle aurait un droit légal aux étrennes, le jour de l’an, tandis que son grand patron recevrait son denier depuis le commencement jusqu’à la fin de l’année. Tout est relatif dans cet univers illusoire; cependant il est nécessaire qu’entre un portier céleste et un portier terrestre il existe une différence de degré. Quant aux étrennes, elles ont existé de tout temps pour les grands comme pour les petits. Caligula, tout Empereur qu’il était, ne dédaignait pas de rester sur pied toute la journée du nouvel an, dans le vestibule de son palais, pour recevoir les strenae de ses sujets tremblants,—avec leurs têtes quelquefois,—pour varier. La Reine-Vierge, 94la «Queen Bess» d’Angleterre mourut, en laissant 3,000 robes de gala, qui représentaient ses dernières étrennes. Et c’est ainsi qu’agissent encore les grands et les petits, dans l’année du Seigneur 1890, sur notre boule détraquée que nous nommons Terra—«le marche-pied» de Dieu.
Ce même Dieu d’Abraham et de Jacob ne se laissait-il pas attendrir par des promesses et des présents, aussi bien que les dieux des nations? Ce Dieu et ces dieux ne recevaient-ils point, tout comme les mortels, des étrennes pour services rendus ou à rendre? Jacob, lui-même, ne marchandait-il pas avec son Dieu, en lui promettant comme étrennes «la dime de tout ce que tu [Dieu] m’aura donné»? Et il ajoutait, ce bon patriarche, à Luz devant «Bethel»:—«Si Dieu est avec moi . . . . s’il me donne du pain à manger, et des habits pour me vêtir . . . certainement, l’Éternel me sera Dieu.» Disant cela, il n’oubliait pas non plus, dans une simple, mais belle cérémonie phallique, d’étrenner la pierre «Bethel» qu’il avait dressée, en arrosant son sommet d’huile (Genèse, xxviii, 18, 20-22).
Cette touchante cérémonie venait aux Israélites directement des Indes, où la pierre de Shiva, le lingam, subit aujourd’hui la même opération exotérique avec de l’huile et des fleurs, à chaque fête des adorateurs du dieu de la Destruction (de la matière brute) et des Yogis.
Tout est resté alors comme jadis. Le nouvel an fait son entrée triomphale dans les pays chrétiens,—en France surtout,—comme il la faisait, il y a deux mille ans, lorsque les Païens le célébraient en se donnant une indigestion de figues et de prunes dorées. Celles-ci ont émigré depuis sur les arbres de Noël, ce qui n’empêche pas toujours qu’elles ne nous viennent des temples de Janus. Il est vrai que les prêtres ne sacrifient plus sur son autel un jeune taureau blanc; —il est remplacé par l’agneau de la même couleur,—mais des hécatombes de quadrupèdes et de volailles sont égorgées annuellement en son honneur, ce jour-là. Il est certain que plus de sang innocent est versé aujourd’hui, pour satisfaire l’appétit vorace d’une seule rue de Paris, le jour de l’an, qu’il n’en fallait pour nourrir toute une ville romaine du temps des Césars. Le doux Julien, le païen, qui retrouva à 95Lutèce ses dieux bien-aimés,—après que les dieux gaulois eurent été, par ordre de César, affublé des faux nez des divinités romaines,—passait ses heures de loisir à apprivoiser des colombes en l’honneur de Vénus. Les féroces potentats qui vinrent après lui,—les fils ainés de l’Église,—n’apprivoisaient que des Vénus, qui en faisaient leurs pigeons. L’histoire servile surnomma le premier, pour plaire à l’Église, l’Apostat, et fit suivre les noms des autres d’épithètes sonnantes:— le «Grand», le «Saint», «le Bel». Mais si Julien devint «Apostat»—ce fut, peut-être, parce qu’il avait en horreur les faux nez; tandis que ses successeurs chrétiens ne seraient probablement pas présentables en bonne société, sans cet appendice artificiel. Un faux nez devient, au besoin, un ange gardien, voire même à l’occasion,—un dieu. Ceci est de l’histoire. La métamorphose des divinités de la Gaule barbare en dieux de l’Olympe et du Parnasse ne s’est pas arrêtée là. À leur tour ces Olympiens eurent à subir une opération par ordre des successeurs de Janus-Saint Pierre,— celle du baptême forcé. À l’aide d’oripeaux et de clinquants, de colle-forte et de ciment romain, nous retrouvons les dieux aimés de Julien, figurant, depuis leur mort violente, sous les titres de Saints et de Saintes béates, dans la Légende doré et le calendrier du bon pape Grégoire.
Le monde est comme la mer: il change souvent d’aspect, mais reste au fond le même. Les faux nez de la civilisation et des cagots ne l’ont guère embelli, cependant . . . . Bien au contraire, puisqu’avec chaque nouvelle année il devient plus laid et plus dangereux. Nous réfléchissons et nous comparons, et le jour du nouvel an moderne ne gagne rien à cette comparison avec ses précurseurs, du temps de l’antiquité, aux yeux d’un philosophe. Les milliards dans les coffresforts et banques des gouvernements ne rendent pas le pauvre peuple plus heureux, ni les riches non plus. Dix pièces de monnaie en bronze, à l’effigie de Janus, données pour étrennes, valaient, en ces jours, plus que dix pièces en or, à l’effigie de la République ou à celle de la Reine, ne valent maintenant; les paniers de prunes dorées, valant quelques sous, contenaient moins de germes d’indigestion que les boîtes de bonbons échangées au jour du nouvel an moderne, 96—ces bonbons représentant, à Paris seulement, une somme de plus d’un demi-million de francs. Cinq cent mille francs de bonbons, à la face du même nombre d’hommes et de femmes mourant de faim et de privations! Portons-nous en esprit, ami lecteur, quinze siècles en arrière, et tâchons d’établir une comparaison entre un diner du nouvel an, dans les années 355 à 360, et un diner analogue en 1890. Allons à la recherche de ce même bon et doux Julien, lorsqu’il habitait le palais des Thermes, qui se nomme aujourd’hui l’hôtel de Cluny,—ou ce qu’il en reste. Le voyez-vous, ce grand général, à son diner à lui, entouré de ses soldats qu’après ses dieux il aime le plus au monde, et qui l’idolâtrent. C’est le ler du mois de janvier et ils célèbrent le jour de Janus. Dans deux jours, le 3 janvier, ils rendront pareil honneur à Isis, patronne de la bonne ville de Lutetia Parisiorum. Depuis, la vierge-mère de l’ancienne Égypte s’est laissé baptiser Geneviève, et cette Sainte et Martyre (de Typhon?) est restée patronne de la bonne ville de Paris,—vrai symbole d’un faux nez fourni par Rome au monde chrétien. Nous ne voyons ni couteaux ni fourchettes, ni argenterie, ni porcelaines de Sèvres, à cette table impérial,—pas même une nappe; mais les viandes et les provisions que les convives font disparaître avec tant d’appétit n’ont nul besoin de passer sous les microscopes de chimistes de la police sanitaire. Aucun produit artificiel ou vénéneux ne fait partie de leur pain ou de leur vin. L’arsenic ne colore pas leurs herbes et légumes d’un faux nez de fraîcheur trompeuse; le vert-de-gris ne se niche point dans les angles de leurs boîtes de conserves, et leur poivre ne se fait pas représenter par la brique rouge pilée dans un mortier. Leur sucre (ou ce qui le remplaçait), n’est point tiré du goudron des roues de leurs chariots de guerre; en avalant leurs liqueurs et cognac, ils n’avalent pas une solution de vieilles bottes de gendarme tirées de la hotte d’un chiffonnier; ils ne dévoraient pas, avec un sourir inconscient sur les lèvres, un bouillon condensé de graisse de cadavres (d’hommes comme d’animaux) et de chiffons et charpie usés dans tous les hôpitaux de Paris,—au lieu de beurre. Car tout ceci est le produit de la culture moderne, le fruit de la civilisation et 97du progres de sciences, et la Gaule, du temps de Julien. n’était qu’un pays sauvage et barbare. Mais ce qu’ils mangeaient, à leur nouvel an, pourrait être mangé avec sécurité et profit (sauf celui des médecins) à nos diners du premier jour de l’an 1890.
«Ils n’avaient ni fourchettes, ni argenterie», me dit-on; «et,—les barbares!—ils mangeaient avec leurs doigts!»
Il est vrai; ils se passaient de fourchettes, comme peutêtre de mouchoirs de poche; mais, en revanche, ils n’avalaient pas, comme nous le faisons tous les jours, leurs ancêtres dans la graisse de cuisine, et les os de leurs chiens dans leur pain blanc.
Qu’on nous donne le choix, et décidément ce n’est pas le diner de gala du jour de l’an de grâce 1890, à Paris, que nous choisirons, mais celui d’il y a mille ans, à Lutèce. Affaire de goût barbare, voyez-vous; une préférence baroque et ridicule, selon l’avis de la majorité—pour le naturel dans le siècle IV, qui nous séduit infiniment plus que les faux nez et l’artificiel en tout du xixme siècle.
H. P. BLAVATSKY
Footnotes