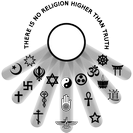Publications: Le Lotus, Paris, Vol. III, No. 18, September, 1888, pp. 321-33
Also at: KH
In other languages:
110
THEOSOPHIE ET BOUDDHISME
[This French essay from the pen of H. P. B. has such close similarity to her Lucifer editorial entitled “The Theosophical Society: Its Mission and Its Future,” published in August, 1888, that it could easily be mistaken for a French translation, especially as it appeared only a month later. A good many of its paragraphs are word for word identical with those of the earlier essay, while others are somewhat different. Some of the material is slightly re-arranged, and the quoted passages from Émile Burnouf are fewer in number than is the case in the Lucifer editorial.
To prevent unnecessary repetition, we have translated into English only a few brief passages which contain additional thoughts, or a different presentation of similar ideas expressed in the earlier essay. In this manner no thought of any importance is lost to the reader who may not be familiar with the French language.––Compiler.]
M. Émile Burnouf, le sanscritiste bien connu, vient de publier dans la Revue des Deux-Mondes (Vol. 88, 15 juillet, 1888), un article intitulé «Le Bouddhisme en Occident», dans lequel il expose ses vues sur la mission et l’avenir de la Société Théosophique. Celle-ci a trop rarement la bonne fortune de recevoir un traitement aussi courtois et des conseils aussi sympathiques, et signes d’un nom aussi cher à tous ceux qui aiment l’Orient, pour que nous ne croyions plaire à nos lecteurs en leur exposant ces critiques d’un penseur sérieux et ces encouragements d’un homme de cœur.
Cet article prouve que la Société Théosophique a enfin pris, dans la pensée du XIXe siècle, la place qui lui est due et qu’elle va entrer dans une ere nouvelle. Il merite donc le respect et l’attention de tous ceux qui ont compris notre œuvre ou qui s’y sont dévoués. Burnouf étudie successivement le Bouddhisme, le Christianisme et la Société Théosophique,
« . . . . trois religions ou associations d’hommes ayant des doctrines identiques, un meme but, et se rattachant à une source commune. Cette source, qui est orientale, était naguère contestée; aujourd’hui, elle est pleinement mise en lumière par les recherches des savants, 111notamment des savants anglais, et par la publication de textes originaux. Parmi ces scrutateurs sagaces, il suffira de citer les noms de Sayce, de Poole, de Beal, de Rhys-David, de Spence Hardy, de Bunsen; il serait difficile d’épuiser la liste». [p. 341.]
La première partie de l’article est consacrée à la biographie du prince de Kapilavastu, à une courte exposition et à un résumé historique du Bouddhisme jusqu’à l’ère chrétienne. La vie de Çâkyamouni est trop connue pour que nous la reproduisions; mais nous devons signaler quelques mots prouvant que Nïrvâna ne veut pas dire annihilation.
Je n’ai point à discuter ici sur la nature du nirvâna. Je dirai seulement que l’idée du néant est absolument étrangère à l’Inde, que l’objet du Bouddha fut de soustraire l’humanité aux misères de la vie terrestre et à ses retours alternés; qu’enfin il passa sa longue existence à lutter contre Mâra et ses anges, qu’il appelait lui-même la Mort et l’armée de la mort. Le mot nirvâna veut bien dire extinction, par example d’une lampe sur laquelle on souffle; mais il veut dire aussi absence de vent.[1] Je pense donc que le nirvâna n’est autre chose que ce requies aeterna, cette 1ux perpetua que les chrétiens aussi demandent pour leurs morts. C’est en ce sens qu’il est entendu dans le texte birman publié il y a quelques années à Rangoun, en anglais, par le révérend Bigandet. [p. 343.]
Peu de conceptions ont été plus mal comprises que celle du Nirvâna, si ce n’est peut-être celle de la divinité. Chez les Juifs et autres Sémites, chez les anciens Grecs et les Romains, et même chez les Brahmanes, le prêtre est le médiateur entre l’homme et Dieu.
. . . Il transmet à Dieu l’offrande et l’adoration du fidèle, Dieu donne en retour ses grâces et ses secours dans la vie, au jour de la mort Dieu reçoit le fidèle parmi ses élus. Pour que cet échange soit possible, il est nécessaire que Dieu soit conçu comme un être individuel, comme une personne, en quelque sorte comme le roi de l’univers, distribuant ses faveurs selon sa volonté, sans doute aussi 112selon la justice. . . .Rien de pareil dans le Bouddhisme. Comme il n’y a pas de dieu personnel, il n’y a pas de saint-sacrifice, il n’y a pas d’intermédiaire. . . . [p. 344.]
. . . . Ce Bouddha n’est pas un dieu qu’on implore; ce fut un homme parvenu au degré suprême de la sagesse et de la vertu. . . .Quant à la nature du principe absolu des choses, que les autres religions nomment Dieu, la métaphysique bouddhique le conçoit d’une toute autre manière et n’en fait pas un être séparé de l’univers. . . . En second lieu, le Bouddha ouvrit son église à tous les hommes, sans distinction d’origine, de caste, de patrie, de couleur, de sexe: «Ma loi, disait-il, est une loi de grâce pour tous». C’était la première fois qu’apparaissait dans le monde une religion universelle. Jusquelà, chaque pays avait eu la sienne, d’où les étrangers étaient exclus. On peut soutenir que, dans les premières années de sa prédiction, le réformateur n’eut pas en vue la destruction des castes, puisqu’il admettait comme un droit légitime la puissance royale et ne luttait point contre elle. Mais l’égalité naturelle des hommes fut une des bases de sa doctrine, les livres bouddhiques sont pleins de dissertations, de récits et de paraboles dont le but est de la démontrer. . . . La liberté en était la conséquence. Aucun membre de l’église ne pouvait imposer à un autre d’y rester malgré soi. . . . . [pp. 345-46.] . . . On ne naissait pas bouddhiste, on le devenait par un choix volontaire et après une sorte de stage que tout prétendant devait subir. Une fois membre de l’Assemblée, on ne se distinguait plus des autres frères; l’unique supériorité que l’on pouvait acquérir était celle de la science et de la vertu. . . . . . Cet amour mutuel, cette fraternité, s’étendait aux femmes et faisait de l’Assemblée une sorte de famille . . . . [p. 346.]
Après avoit raconté les progrès du Bouddhisme dans le Sud et le Nord de l’Inde, chez les Mazdéens et lesJuifs, M. Burnouf remarque que ceux-ci ont emprunté au Bouddhisme leur idée du Messie. L’influence orientale a été nettement discernée dans l’histoire juive depuis la captivité; la doctrine de la réincarnation vient aussi des Indes.
On regarde les esséniens comme formant le lien et le point de rencontre entre les rabbins, les gnostiques juifs, les platoniciens ou pythagoriciens d’une part, le parsisme et le bouddhisme d’autre part . . . . Ils condamnaient les sacrifices sanglants, comme le Bouddha et la Synagogue, et les remplaçaient par la méditation et par le sacrifice des passions. . . .s’abstenaient de viande et de vin. . . . pratiquaient la communauté des biens, l’aumône, l’amour de la vérité, la pureté dans les actions, dans les paroles et dans les pensées . . . proclamaient l’égalité des hemmes, proscrivaient l’esclavage et 113ramplaçaient la discorde par la charité. . . . les premiers chrétiens étaient esséniens. . . . [pp. 352-53.]
En comparant la vie de Jésus et celle de Bouddha, on voit que leurs biographies se divisent en deux parties, la légende idéale et les faits réels. Or, la partie légendaire est identique dans les deux. Au point de vuc théosophique, cela cst facile à expliquer puisque ces légendes sont basées sur le cycle de l’initiation. Enfin l’auteur compare cette partie légendaire avec les traits correspondants des autres religions, entre autres avec l’histoire védique de Visvakarman. D’après lui, c’est seulement au concile de Nicée que le Christianisme rompit officiellement avec le Bouddhisme ecclésiastique; cependant il regarde le Credo adopté par le concile comme le développement de la formule: «Le Bouddha, la loi, l’église» (Buddha, Dharma, Sangha).
Quelques pages sont consacrées aux ramifications de la secte des Esséniens, qui n’avaicnt pas été complètement absorbées par la religion du Christ. Telles sont les sectes des Mandéens, des Sabéens ou Manichéens; enfin les Albigeois d’une part, et de l’autre les Pauliciens, dont l’influence sur le protestantisme est discernable, représentent les derniers vestiges de l’influence bouddhiste en Occident. Les Manichéens étaient, dans l’origine, des Samans ou Çramanas, ascètes bouddhistes dont saint Hippolyte mentionne la présence à Rome au milieu du IIIe siècle. M. Burnouf explique leur dualisme par rapport à la double nature de l’homme, le bien et le mal, le mal étant le Mâra de la legende bouddhiste. Il montre que les Manichéens dérivaient leurs doctrines du Bouddhisme, plus directement quc les chrétiens; cn conséquence une lutte mortelle s’éleva entre les deux, lorsque l’Église chréticnne prit corps et prétendit posséder scule et exclusivement la vérité. Cette idée est en contradiction directe avec les conceptions fondamentales du Bouddhisme, et ceux qui la professaient devaient ctre naturcllemcnt adversaires acharnés des Manichéens. C’est ainsi l’csprit juif d’exclusion qui arma contre les Manichéens le bras séculier des États chrétiens. La persécution fut terrible; «ils furent tellement écrasés, que leur multitude, alors 114immense, se dissipa comme une fumée». Les théosophes peuvent donc considérer les persécutions ecclésiastiques comme une des plus nobles portions de leur héritage. Aucune société n’a été plus férocement calomniée et persécutée par l’odium theologicum, que l’association théosophique et ses fondateurs, depuis que les églises chrétiennes en sont réduites à n’employer d’autres armes que la langue.
Ayant suivi cette haute ligne depuis l’Inde, à travers la Palestine jusqu’en Europe, nous croyons devoir citer entièrement quelques paragraphes que M. Burnouf consacre à la Société théosophique:
L’analyse nous montre dans notre société contemporaine deux choses essentielles: I’idée d’un Dieu personnel chez les croyants, et chez les philosophes, la disparition à peu près complète dela charité. L’élément juif a repris le dessus, et l’élément bouddhique du christianisme s’est voilé.
C’est donc un des phénomènes les plus intéressants, sinon les plus inattendus de nos jours, que la tentative faite en ce moment de susciter et de constituer dans le monde une société nouvelle, appuyée sur les mêmes fondements que le bouddhisme. Quoiqu’elle ne soit qu’à ses commencements, sa croissance est si rapide que nos lecteurs seront bien aises de voir leur attention appelée sur ce sujet. Elle est encore en quelque sorte à l’état de mission, et sa propagation s’accomplit sans bruit et sans violence. Elle n’a pas même un nom définitif; ses membres se groupent sous des noms orientaux, mis en tête de leurs publications: Isis, Lotus, Sphinx, Lucifer. Le nom commun qui prévaut parmi eux pour le moment est celui de Société Théosophique.
Cette société est bien jeune; elle a déjà pourtant une histoire. Elle fut fondée en 1875, à New-York, par un très petit groupe de personnes, inquiètes de la rapide décadence des idées morales dans l’âge présent. Ce groupe s’intitula: «Société Théosophique aryenne de New-York». L’épithète d’aryenne indiquait assez que la Société se séparait du monde sémitique, notamment des dogmes juifs; la partie juive du christianisme devait être réformée, soit par une simple amputation, soit, comme cela est arrivé en effet, par voie d’interprétation. Toutefois, un des principes de la société était la neutralité en matière de secte, et la liberté de l’effort personnel vers la science et la vertu. . . . .
La société n’a ni argent ni patrons; elle agit avec ses seules ressources éventuelles. Elle n’a rien de mondain. Elle n’a aucun esprit de secte. Elle ne flatte aucun intérêt. Elle s’est donné un idéal moral très élevé, combat le vice et l’égoïsme. Elle tend à l’unification des religions, qu’elle considère comme identiques dans leur origine philosophique; mais elle reconnaît la suprématie de la vérité. Le 115Lotus, revue mensuelle qu’elle publie à Paris, a pris pour épigraphe la devise sanscrite des mahârâjahs de Bénares: «Satyân nâsti paro dharmah, il n’y a pas de religion plus élevée que la vérité».
Avec ces principes et au temps où nous sommes, la societé ne pouvait guère s’imposer de plus mauvaises conditions d’existence. Cependant elle a progressé avec une étonnante rapidité. . . . [pp. 366-67.]. . . En Amérique, la société a pris une grande extension dans ces derniers temps; ses branches se sont multipliées, puis se sont en quelque sorte fédéralisées autour de l’une d’entre elles, la branche de Cincinnati. . . . .
Comme le second objet que se propose l’association est l’etude des littératures, des religions, des sciences aryennes et orientales, et qu’une partie de ses membres poursuit l’interprétation des anciens dogmes mystiques et des lois inexpliquées de la nature, on pourrait voir en elle une sorte d’académie hermétique, assez étrangère aux choses de la vie. On est vite ramené à la réalité par la nature des publications qu’elle fait ou qu’elle recommande, et par la déclaration contenue dans le Lucifer, publié à Londre, et reproduite dans Le Lotus du mois de janvier dernier: «N’est pas théosophe qui ne pretique pas l’altruisme (le contraire de l’égoïsme); qui n’est pas préparé à partager son dernier morceau de pain avec plus faible ou plus pauvre que lui; qui néglige d’aider l’homme, son frère, quelque soit sa race, sa nation ou sa croyance, en quelque temps et quelque lieu qu’il le voit souffrant, et fait la sourde oreille au cri de la misère humaine; qui enfin entend calomnier un innocent, théosophiste ou nom, sans prendre sa défense, comme il le ferait pour lui-même». Cette déclaration n’est pas chrétienne, puisqu’elle ne tient pas compte des croyances, qu’elle ne fait de prosélytisme pour aucune communion, et que, en fait, les chrétiens ont ordinairement employé la calomnie contre leurs adversaires, par exemple contre les manichéens, les protestants et les juifs. Elle est bien moins encore musulmane ou brahmanique. Elle est purement bouddhique; les publications pratiques de la sociéte sont ou des livres bouddhiques traduits, ou des ouvrages originaux inspirés par l’enseignement du Bouddha. La Société a donc un caractère bouddhique.
Elle s’en défend un peu dans la crainte de prendre une couleur sectaire et exclusive. Elle a tort: le bouddhisme vrai et original n’est pas une secte, c’est à peine une religion. C’est plutôt une réforme morale et intellectuelle, qui n’exclut auculle croyance, mais n’en adopte aucune. C’est ce que l`ait la Sociéte Théosophique . . . . [pp. 368-69.]
En parlant du Bouddhisme, M. Burnouf` a constamment en vue le Bouddhisme primitif, cette magnifique floraison de vertu, de pureté et d’amour dont le cygne de Kapilavastu jeta les semences sur le sol de l’Inde. Sur ce point, nous sommes d’accord avec lui. Le code de 116moral établi par Bouddha est le plus grand trésor qui ait été donné à l’humanité: cette religion, ou plutôt cette philosophie, se rapproche de la vérité ou science secrète, bien plus qu’aucune autre forme ou croyance exotérique. Nous ne pouvons proposer un idéal moral plus élevé que ces nobles principes de fraternité, de tolérance et de détachement, et la morale bouddhiste représente à peu près exactement la morale théosophique. En un mot, on ne pourrait nous honorer davantage qu’en nous appelant bouddhistes, si nous n’avions l’honneur d’être théosophes.
Mais la Société Théosophique se défend très sérieusement, et pas seulement pour la forme, d’avoir été créée «pour propager les dogmes du Bouddha». Notre mission n’est pas de propager des dogmes pas plus bouddhistes que védiques ou chrétiens; nous sommes indépendants de toute formule, de tout rituel, de tout exotérisme. Nous avons pu, aux tentatives d’envahissement faites par des chrétiens zélés mais chrétiens, opposer les nobles principes de l’éthique bouddhiste. Les présidents de la Société ont pu se déclarer personnellement bouddhistes, et on le leur a assez reproché; l’un d’eux a consacré sa vie à la régénération de cette religion dans sa terre d’origine. Que ceux-là lui jettent la pierre, qui ne comprennent pas les besoins de l’Inde actuelle et ne désirent pas le relèvement de cette antique patrie des vertus. Mais cela n’engage pas le corps théosophique, comme tel, vis-à-vis du bouddhisme ecclésiastique, pas plus le christianisme de certains de ses membres ne l’engage vis-à-vis d’aucune église chrétienne. Précisément parce que le Bouddhisme actuel a besoin d’être régénéré, débarrassé de toutes les superstitions et de toutes les restrictions qui l’ont envahi comme des plantes parasites, nous aurions grand tort de chercher à greffer un bourgeon jeune et sain sur une branche qui a perdu de sa vitalité, bien qu’elle soit peut-être moins desséchée que les autres rameaux. Il est infiniment plus sage d’aller tout de suite aux racines, aux sources pures et inaltérables d’où le Bouddhisme lui-même a tiré sa sève puissante. Nous pouvons nous éclairer directement à la pure «Lumière de 1171’Asie»; pourquoi nous attarderions-nous dans son ombre déformée? Malgré le caractère synthétique et théosophique du Bouddhisme primitif, le Bouddhisme actuel est devenu une religion dogmatique et s’est morcelé en sectes nombreuses et hétérogènes. L’histoire de cette religion et des autres est là pour nous avertir contre les demi-mesures. Voyez la réforme partielle appelée Protestantisme: les résultats sont-ils assez satisfaisants pour nous engager à des raccommodages? L’Arya Samaj même n’est après tout qu’un effort national, tandis que la position essentielle de la Société Thésophique est d’affirmer et de maintenir la vérité commune à toutes les religions, la vérité vraie, que n’ont, pu souiller les inventions, les passions, ni les besoins des âges, et d’y convier tous les hommes, sans distinction de sexe, de couleur ou de rang,—et, qui plus est, de croyance.
M. Burnouf nous met en garde contre l’indifférence. D’où vient celle-ci? De l’indolence d’abord, ce fléau de l’humanité, puis du découragement. Et si l’homme est lassé de symboles et de cérémonies dont le prêtre ne donne jamais l’explication, mais dont il tire de beaux bénéfices, ce n’est pas en substituant des bonzeries à nos chapelles que nous secouerons cette torpeur. Le moment est venu où toutes les cloches n’ont qu’un son: elles sonnent l’ennui. Prétendre réinstaller la religion de Bouddha sur les ruines de celle de Jésus, ce serait donner à l’arbre mort le soutien d’un bâton desséché. Notre critique lui-même nous avertit que l’humanité est lassée jusque des mots Dieu, religion. Remarquons, à ce propos, que le terme théosophie, qui signifie sagesse divine, n’implique pas nécessairement la croyance à un dieu personnel. Nous croyons la doctrine des théosophes suffisamment exposée pour n’avoir pas besoin d’insister à ce sujet. Ammonius Saccas, Plotin, Jamblique, Porphyre, Proclus étaient des théosophes; et, ne fût-ce que par respect pour ces hommes, nous pouvons bien conserver ce titre.
Non, le Sangha des Bouddhistes ne peut être rétabli dans notre civilisation. Quant au Bouddha lui-même, nous le vénérons comme le plus grand sage et le plus grand 118bienfaiteur de l’humanité, et nous ne perdrons aucune occasion de revendiquer ses droits à l’admiration universelle. Mais en présence de cette loi terrible qui fait toujours dégénérer l’admiration en adoration et celle-ci en superstition, en présence de cette cristallisation désespérante qui s’opère dans les cerveaux disposés à l’idolâtrie et en exclut tout ce qui n’est pas l’idole, serait-il sage de réclamer pour le frère aîné de Jésus la place étroite où ce dernier subit un culte sacrilège? Hélas, se peut-il qu’il y ait des hommes assez egoïstes pour ne pouvoir aimer qu’un être, assez serviles pour ne vouloir servir qu’un maître à la fois!
Reste donc Dharma: nous avons dit en quelle haute estime nous tenons la morale bouddhiste. Mais la Théosophie s’occupe d’autre chose que de règles de conduite: elle réalise ce miracle de pouvoir réunir une morale pré-bouddhiste à une métaphysique pré-védique et à une science pré-hermétique. Le développement théosophique fait appel à tous les principes de l’homme, à ses facultés intellectuelles comme à ses facultés spirituelles, et les deux derniers objets de notre programme ont plus d’importance que M. Burnouf ne semble leur en accorder. Nous pouvons lui assurer que si notre Société reçoit l’adhésion de beaucoup d’hommes de sa valeur, elle sera le canal d’un torrent d’idées nouvelles empruntées à des sources antiques: un torrent d’innovations artistiques, économiques, littéraires et scientifiques autant que philosophiques, et autrement fécond pour l’avenir que la première Renaissance. Il y aura là plus qu’une coloration académique: l’académie elle-même apprendra l’alphabet qui permet de lire clairment, entre les lignes, le sens si obscur et souvent si insignifiant en apparence des écritures antiques. Cette clef est à la portée de ceux qui ont le courage de lever la main pour la prendre. Et cette clef, Bouddha la possédait, car il était un adepte de haut rang. Il est vrait qu’il n’existe pas de mysteres ou d’ésotérisme dans les deux principales églises bouddhistes, celle du Sud et celle du Nord. Les Bouddhistes peuvent bien se contenter de la lettre morte des doctrines de Siddhârtha Bouddha, car jusqu’à ce 119jour, il n’en est pas de plus noble, heureusement; il n’en est pas qui puisse produire d’effet plus important sur l’éthique des masses. Mais c’est ici la grande erreur de tous les orientalistes. Il y a une doctrine ésotérique, une philosophie qui ennoblit l’âme, derrière le corps extérieur du Bouddhisme ecclésiastique. Celui-ci, pur, chaste et immaculé comme la neige vierge des sommets de l’Himalaya, est cependant aussi froid et aussi désolé en ce qui concerne la condition de l’homme post mortem. Le système secret était enseigné aux Arhats seuls, généralement dans le souterrain de Saptaparna (Sattapani de Mahavamsa), connu de Fa-hian sous le non de grotte Cheta près du mont Baibhâr (en pali Webhâra), à Rajagriha, ancienne capitale de Magadha; il était enseigné par le seigneur Bouddha lui-même, entre les heures de Dhyana (contemplation mystique). C’est de cette grotte, appelée au temps de Sakyamuni, Saraswati ou cave des bambous, que les Arhats initiés dans la sagesse secrète emportèrent leur instruction et leur science au delà de l’Himalaya, où la doctrine secrète est enseignée jusqu’à ce jour. Si les Indiens du Sud, les envahisseurs de Ceylan n’avaient «amoncelé en piles aussi hautes que le sommet des cocotiers» les ollas des bouddhistes, et ne les avaient brûlés, de même que les Chrétiens brûlèrent toutes les archives secrètes des Gnostiques et des initiés, les Orientalistes en auraient la preuve, et nous n’aurions pas besoin d’affirmer maintenant ce fait bien connu.
Les trois objets du programme théosophique peuvent se résumer par les trois mots Amour, Science, Vertu, et chacun est inséparable des deux autres. Revêtue de ce triple airain, la Société Theosophique accomplira le miracle que M. Burnouf lui demande et terrassera le dragon de la «lutte pour l’existence». Elle le fera non pas en niant l’existence de la loi en question, mais en lui assignant sa juste place dans l’ordre harmonieux de l’univers; en en dévoilant la nature et la signification; en montrant que cette pseudo-loi de vie est en réalité une loi de mort, une fiction des plus dangereuses en ce qui concerne la famille humaine. La «soi-conservation», sur de pareilles données, est en vérité un suicide lent et sûr, une politique 120d’homicide mutuel. Par son application pratique, les hommes s’enfoncent et reculent de plus en plus vers le degré animal de l’évolution. La lutte pour l’existence, même sur les données de l’économie politique, qui ne s’élève pas au-dessus du plan matériel, ne s’applique qu’a l’être physique et pas du tout à l’tre moral. Or, il est assez vraisemblable, à première vue, pour qui a un peu approfondi la constitution de notre univers illusoire en paires de contraires, que si l’égoïsme est la loi de l’extrémité animale, l’altruisme doit être la loi de l’autre extrême; la formule du combat pour la vie est de moins en moins vraie à mesure qu’on monte les degrés de l’échelle, c’est-à-dire à mesure que l’on se rapproche de la nature spirituelle: mais pour ceux qui n’ont pas développé les facultés de cette partie de leur nature, les lois qui la régissent doivent rester à l’état de conviction sentimentale. La théosophie nous indique la route à suivre pour que cette intuition se change en certitude, et le progrès individuel qu’lle demande à ses disciples est aussi la seule sauvegarde contre le danger social dont nous menace notre critique; pour réformer la société, il faut commencer par se réformer soi-même. Ce n’est pas la politique de soi-conservation, ni les intérêts d’une personnalité ou d’une autre, sous leur forme finie et physique, qui peuvent nous conduire au but désiré et abriter la Société Théosophique contre les effets de l’ouragan social, quand même cette personnalité représenterait l’idéal de l’homme, quand même cette égide serait le Bouddha en personne. Le salut est dans l’affaiblissement du sens de séparation entre les unités qui composent le tout social: or ce résultat ne peut être accompli que par un procédé d’éclairement intérieur. La violence n’assurera jamais le pain et le confort pour tous; et ce n’est pas non plus par une froide politique de raisonnement diplomatique que sera conquis le royaume de paix et d’amour, d’aide mutuelle et de charité universelle, la terre promise où il y aura «du pain pour tout le monde». Quand on commencera à comprendre que c’est précisément l’égoïsme personnel et féroce, grand ressort de la lutte pour l’existence, qui est au fond la seule cause de la misère humaine; que c’est 121encore l’égoïsme national cette fois, et la vanité d’État, qui provoquent les gouvernements et les individus riches a enterrer d’énormes capitaux et à les rendre improductifs en érigeant des églises splendides et en entretenant un tas d’évèques paresseux, vrais parasites de leurs troupeaux; alors seulement l’humanité essayera de remédier au mal universel par un changement radical de politique. Ce changement, les doctrines théosophiques seules peuvent l’accomplir pacifiquement. C’est par l’nion étroite et fraternelle des Soi supérieurs des hommes, par la croissance de la solidarité d’âme, par le développement de ce sentiment qui nous fait souffrir en pensant aux souffrances d’autrui, que pourra être inauguré le règne de l’égalité et de la justice pour tous, et que s’établira le culte de l’Amour, de la Science et de la Vertu, défini dans cet admirable axiome! «Il n’y a pas de religion plus élevée que la vérité».
H. P. BLAVATSKY.
Footnotes
- ↑ Le fait que Nirvâna ne veut pas dire annihilation a été affirmé et répété dans Isis Unveiled, dont l’auteur a discuté le sens étymologique donné par Max Müller ou d’autres, et a montré que «l’extinction d’une lampe» n’implique même pas l’idée que Nirvâna soit «l’extinction de la conscience». (Voyez Vol. I, p. 290, et Vol. II pp. 116-17, 286, 320, 566, etc. . .)
Footnotes